|
| |
Biamont |
 |
|
Aujourd'hui,
le Tour s'engage vers Enghien avant de bifurquer brusquement
à droite et de plonger vers Biamont. Pour atteindre
ce dernier lieu-dit, on suit le creux d'un petit vallon
de la rive gauche de la Senne.
Biamont constitue un des points importants du Tour.
Les pèlerins doivent en effet y franchir une
première fois la Senne. L'autre traversée,
au chemin dit des Trois Planches, sera moins pénible
puisqu'effectuée très en amont et donc
en un endroit où la rivière présente
un débit moins important.
La tradition orale et des photographies rappellent
les conditions dans lesquelles, au début de
ce siècle encore, les porteurs des châsses
franchissaient la rivière à gué,
à quelques mètres en aval de la chute
du moulin. Lors de la transformation du site en vue
de la construction de la machine hydraulique destinée
à refouler l'eau vers le château d'eau
du faubourg, on construisit un pont franchissant la
Senne à cet endroit. Ainsi se trouvait perdue
l'ancienne coutume qui consistait à passer
les châsses à gué.
Le lien entre le moulin et la traversée de
la Senne est assez naturel. Du fait de leurs fonctions,
les moulins attiraient un trafic assez considérable.
Les chemins s'y rejoignaient. La clientèle
ou les passants y trouvaient un point de traversée.
Le moulin devenait ainsi le lieu privilégié
du franchissement de la rivière. Pour le charroi,
l'opération s'effectuait habituellement sur
le site de la "basse-rivière", en
aval de la chute des installations hydrauliques. Côté
"basse-rivière", les eaux se répandent
en éventail tout en perdant progressivement
de leur force et de leur profondeur. C'est également
un endroit où la boue ne s'accumule guère.
C'est, au contraire, un sol ferme que l'on trouve
sous les pieds. La retenue d'eau peut enfin être
telle que le gué de la basse rivière
se trouve presque complètement à sec,
ce qui facilite encore d'autant le passage.
Pour leur part, les piétons et l'ensemble des
autres pèlerins franchissaient la Senne en
empruntant la passerelle placée au-dessus des
vannes (tant du côté de la roue que du
côté du trop-plein de la rivière).
Ils longeaient ensuite le barrage qui coupait à
cet endroit la vallée de la Senne.
Le toponyme "Biamont" est signalé
dès 1180. Il s'agit déjà à
ce moment d'un lieu occupé par un noyau de
peuplement. Au moyen âge, le mot "mont"
désigne moins un sommet (crête ou colline
proprement dite) qu'une montée ou un versant
de vallée sur le côté d'une rivière.
De ce point de vue, Biamont évoque simplement
le versant arable de la Senne à cet endroit.
Dans le fond de la vallée, la Senne traverse
aujourd'hui les prairies et se trouve complètement
emprisonnée dans un lit canalisé.
On trouvait auparavant en amont du barrage une sorte
de pré marécageux qui était la
trace de l'ancien vivier formant la réserve
d'eau du moulin. Un document de 1442 mentionne dans
ce même secteur les "Rosoirs" de la
ville. Ce toponyme désigne très probablement
des viviers qui se trouvaient en amont de Biamont,
à proximité immédiate du moulin.
Par ce biais et par d'autres documents, l'existence
d'un moulin à Biamont est attestée dès
le 15e siècle. L'aménagement du site
dans la perspective de l'utilisation de l'énergie
hydraulique est sans doute beaucoup plus ancienne.
La structure du site de Biamont a été
considérablement modifiée lors de la
construction de la "machine à eau"
au début de ce siècle. Cependant, elle
se laisse encore partiellement deviner.
Jusqu'à l'aube de notre siècle, le moulin
de Biamont se trouvait dans le bâtiment formant
angle droit avec l'exploitation agricole que l'on
peut voir dans la partie la plus basse du chemin de
Biamont. Placé de cette manière, le
moulin constituait la suite naturelle de la ferme.
On peut penser qu'avec la ferme il formait à
l'origine un seul et même ensemble.
Le moulin de Biamont était du type moulin-barrage,
l'"usine" occupant l'extrémité
du
|
|
|
barrage,
côté rive gauche. .
De l'autre côté, la levée de
terre se terminait dans l'alignement de l'entrée
d'une ferme. Cette dernière formait en quelque
sorte le pendant du moulin. A cet endroit précis
se dresse une chapelle, la deuxième où
font halte les pèlerins du Grand Tour.
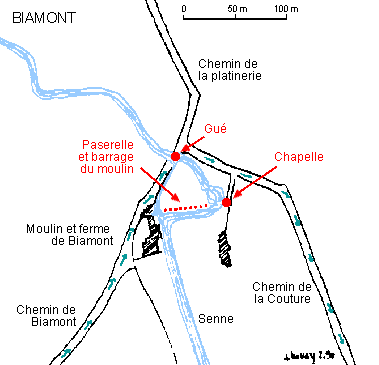 |
Débouchant
de la passerelle du moulin et du sentier qui
suivait la crête du barrage, le pèlerin
se trouvait directement en face de cette chapelle.
Du fait de la métamorphose du site,
le pèlerin actuel la laisse à
une cinquantaine de mètres sur sa droite.
Les porteurs de la châsse et les cavaliers,
quant à eux, contournaient d'abord
le moulin, Ils traversaient ensuite le bief
destiné à ramener l'eau de la
roue vers le cours principal de la Senne.
C'est, enfin, à hauteur de l'actuelle
machine hydraulique que les porteurs franchissaient,
à gué, le cours principal de
la rivière, cours principal qu'une
écluse commandait à l'autre
extrémité de la digue.
Sitôt franchie la rivière, les
pèlerins pouvaient se regrouper sur
l'assiette de l'ancien "grand chemin"
d'Enghien, prolongement du chemin de Steenkerque
et du chemin de la Guélenne.
De là, aujourd'hui comme hier, les
pèlerins prennent la direction de Soignies,
par l'actuel chemin de la Couture.
|
En
1911, la création de la "machine à
eau" de Biamont entraîna une profonde transformation
de tout le secteur, au point même de le rendre
quasiment méconnaissable. Le moulin fut désaffecté
et la digue en bonne partie effacée. On canalisa
la rivière vers l'amont pour empêcher
tout risque d'inondation. De nouvelles vannes furent
construites en contrebas de l'ancien moulin de manière
à accumuler l'eau destinée à
actionner la turbine de la machine hydraulique. Juste
en aval du bâtiment édifié pour
abriter cette machine, on construisit un pont pour
permettre le franchissement aisé de la rivière.
Désormais les pèlerins évitèrent
la passerelle du moulin et les porteurs des châsses
purent franchir le cours d'eau à pieds secs.
Signalons encore que cette "machine à
eau" (bien millésimée) fut sans
doute une des dernières grandes installations
à énergie hydraulique construite dans
le Hainaut.
A l'heure actuelle, les installations en rapport avec
la rivière sont complètement désaffectées.
L'évolution de la topographie du site de Biamont
explique pourquoi la chapelle du Tour se trouve à
l'entrée de la ferme, en retrait par rapport
au chemin de la Couture. Cette chapelle doit en effet
être replacée, comme nous l'avons vu,
dans la perspective de l'ancien itinéraire
des pèlerins.
La chapelle de Biamont se présente sous la
forme d'une grande pierre encastrée dans le
mur d'enceinte de la ferme, à droite du grillage
d'entrée. Au sommet de cette pierre se trouve
une niche contenant une statue de Notre-Dame de Tongre.
On peut lire sur le monument l'inscription suivante
"A la plus grande gloire de Dieu. Fut érigé
à l'honneur de Notre Dame de Tongre par Alexandre
Senglier, décédé le 11 xbre 1837,
âge de 62 ans, son épouse Marie-Josephe
Werts, décédée le 13 février
1861, âgée de 87 ans".
Alexandre Senglier était en même temps
le propriétaire de cette ferme (qu'il exploitait
comme blanchisserie en se servant des vastes prés
bordant la Senne) et du moulin voisin
|
|
| |
|
 |
|
|
|
|
|